Nous sommes tous des cyborgs [2/2]
Seconde partie de la réflexion d'Ariel Kyrou sur le "devenir cyborg", qui se penche sur le travail de techno-prophètes artistes et engagés.
Seconde partie de “Nous sommes tous des cyborgs”, par Ariel Kyrou.
Le cyborg de Donna Haraway dans la cité de Keiichi Matsuda
« Les dichotomies qui opposent corps et esprit, organisme et machine, public et privé, nature et culture, hommes et femmes, primitifs et civilisés, sont toutes idéologiquement discutables », écrivait en 1985 Donna Haraway, qui ajoutait, déroulant sa pensée du monde des idées à l’anticipation de renversements de l’ordre bourgeois qui n’en étaient alors qu’à leurs prémisses :
La maison, le lieu de travail, le marché, l’arène publique, le corps lui-même : tout fait aujourd’hui l’objet de ces dispersions et connexions polymorphes presque infinies1.
Vingt-cinq ans après ce manifeste visionnaire, Keiichi Matsuda prend acte de l’explosion des frontières entre le public et le privé, le bureau et la maison, l’extérieur et l’intérieur mais aussi l’organisme et la machine à l’aube du tsunami numérique. Là où Haraway en appelait au détournement du phénomène de « cyborguisation » du monde par « l’informatique de la domination » au profit de la capacité des femmes à se libérer des codes de production et de reproduction de la « domination masculine, raciste et capitaliste », Matsuda se l’approprie à des fins de bouleversement des codes du vivre ensemble urbain.
Le premier de ses dix principes de cités adaptées au « dernier modèle de cyborg, le CY-2010 », sonne de façon paradoxale. Il a pour titre « Déprogrammer ». Déprogrammer non pas les ordinateurs mais la mécanique des architectes et leur manie d’assigner tous les lieux à une identité, à une fonction précise et figée pour toujours. Car il s’agit, pour reprendre sa troisième règle, de « designer des espaces, et non des murs », afin de laisser nos yeux, nos oreilles voire tous nos sens et in fine notre esprit recomposer notre environnement de vie selon nos lubies par la grâce de l’augmentation de la réalité. Certes, il nous faudra toujours des toilettes bien définies comme telles. Mais pour le reste, selon le jeune designer et architecte, toutes les pièces de nos maisons et de nos entreprises pourraient être transformées à loisir et selon les moments en « salle à manger », « salle de conférence », « librairie », « boutique », ou pourquoi pas (mais ça il ne le dit pas) « chambre à coucher » avec par exemple canapés pliables et jeux de lumières différents.
Les lieux seront « liquides », s’adaptant en permanence grâce aux prodiges du virtuel à nos humeurs, entre le calme et la frénésie, à nos activités, seuls ou au contraire avec des collègues, notre compagnon ou nos enfants. Nous pourrons d’ailleurs décider nous-mêmes de transformer tel mur, telle affiche ou telle image de notre contexte immédiat au fur et à mesure de nos pas, via le re-façonnage du réel que permettraient nos lentilles, nos lunettes à transmuter ce que nous percevons… ou pourquoi pas notre implant Google !
« Le cyborg est un moi postmoderne individuel et collectif, qui a été démantelé et ré-assemblé. Le moi que doivent coder les féministes (( Donna Haraway, op. cit., page 572 )) », affirme Haraway. Matsuda se situe effectivement dans cette lignée constructiviste, mais avec une nuance : le code, pour lui, sert moins aux individus afin qu’ils se programment eux-mêmes qu’à la déprogrammation puis à la reprogrammation de l’environnement proche tel qu’ils le perçoivent.
La féministe s’attaque au corps humain lui-même, mais elle ne le fait que par une puissante figure de rhétorique, d’une fiction permettant de décoder le réel et d’agir sur lui. Le designer, une génération plus tard, est à la fois plus modeste et plus ambitieux.
Il est plus modeste qu’elle, car le cœur de son anti-utopie, de son manifeste de jeux, d’événements multiples, de transformation et d’extension des espaces publics est de l’ordre de la perception. L’électronomade passe au prisme de ses désirs ou de ses besoins la réalité qu’il perçoit. Autrement dit : il vit une mutation du voir et du sentir, pilotée par ses soins, mais pas une mutation de sa chair pesante. Matsuda est à l’inverse plus ambitieux qu’Haraway, parce qu’il ne se contente pas d’un roman opérationnel, d’une fiction à même de changer le monde. Le codage, tel qu’il le met en scène dans ses films comme dans son texte, se concrétise via la danse des 0 et des 1 au cœur de notre vie réelle, même si elle ne signe que la préhistoire de notre devenir cyborg. Il s’inscrit dans une zone floue, une toute nouvelle couche de réalité ou d’e-réalité à l’intersection de l’intérieur et de l’extérieur de chacun, pleine d’informations, de décryptages, mais aussi potentiellement d’altérations de nos perceptions, donc de nous-mêmes, au-delà même de notre surface.
Déjà en 1985, Haraway affirmait :
Nos meilleures machines sont faites de soleil, toute légères et propres car elles ne sont que signaux, vagues électromagnétiques, sections du spectre. Elles sont éminemment portables, mobiles – un sujet d’immense douleur à Détroit et Singapour. Matériels et opaques, les gens sont loin de cette fluidité. Les cyborgs sont éther, quintessence. C’est justement leur ubiquité et leur invisibilité, qui font des cyborgs ces machines meurtrières. Difficiles à voir matériellement, ils échappent aussi au regard politique. Ils ont trait à la conscience – ou à sa simulation.2
Vingt-cinq ans plus tard, c’est cette prémonition, cet éclair lumineux de la militante que Matsuda concrétise, mais de façon moins radicale voire plus ambiguë, car en prise directe avec l’exercice de son métier de designer et d’architecte. Donna Haraway frappe les esprits de ses lecteurs d’une vision de l’extérieur de leur monde, pour mieux les secouer avant qu’ils ne soient entièrement soumis à « l’informatique de la domination ». Elle en appelle à un détournement politique de ce biopouvoir à la puissance surmultipliée.
Le jeune Keiichi Matsuda, qui vit entre Tokyo et Londres, ne peut se satisfaire d’un manifeste, aussi nécessaire soit-il. Car lui se trouve dans l’obligation de transiger avec son réel au quotidien. Il navigue à la fois au-dedans et au-dehors de cette informatique de la domination, elle-même très trouble. Il est tout autant acteur que critique de notre devenir cyborg. Face à l’absence de toute fin politique qu’incarne Arika Millikan et son implant Google, il met en scène les risques de l’éternelle manipulation par les marques et leurs logiques d’addiction, d’une vie « diminuée » et non « augmentée ». D’une manière forcément mutante et imprédictible, les songes scientifiques de Kline et Clynes d’il y a un demi-siècle et les rêves poético-politiques de Haraway il y a une génération prennent corps peu à peu. Matsuda en prend acte, et c’est pourquoi il tente de construire une « anti-utopie » post-situationniste, non seulement à penser mais à vivre hic & nunc par le CY-2010 et ses futurs modèles plus sophistiqués.
Machines humanoïdes ou corps mutants ?
Le manifeste « contre-nature » de Donna Haraway reste un point référence, plus impertinent que jamais à l’heure de la « réalité augmentée », de « l’Internet des objets », de la biogénétique, des nanotechnologies et des rêves de maîtrise scientiste qui les accompagnent. Sa clé réside dans l’incertitude même du devenir qu’il trace :
La politique du cyborg est la lutte pour le langage et la lutte contre la communication parfaite, contre le code unique qui traduit parfaitement chaque sens, dogme du phallocentrisme. C’est pourquoi la politique du cyborg insiste sur le bruit et préconise la pollution, jouissance des fusions illégitimes de l’être humain et de la machine (( Donna Haraway, op. cit., page 593 ))
Sur ce registre, les visions de techno-prophètes comme le roboticien Hans Moravec, contemporaines de son Manifeste cyborg, seraient son antithèse à l’inverse légitime : non pas la réinvention de la femme à partir d’un réencodage de ce que nous avons de plus fondamentalement humain, débarrassée du mythe du retour à l’origine, mais les retrouvailles de l’homme avec le Paradis perdu par la grâce de l’implant final ou, plus fou, du téléchargement de notre esprit dans la carcasse d’un robot, par exemple arborescent, à la « colossale intelligence », à la « coordination extraordinaire », à la « rapidité astronomique » et à « l’immense sensibilité à son environnement ». Soit un enjeu que Moravec résumait ainsi en 1988 :
Trouver un procédé qui permette de doter un individu de tous les avantages de la machine sans qu’il perde son identité personnelle. Beaucoup de gens ne vivent aujourd’hui que grâce à un arsenal croissant d’organes artificiels et autres pièces de rechange. Un jour, grâce en particulier aux progrès des techniques robotiques, ces pièces de rechange seront meilleures que les originaux. Alors, pourquoi ne pas tout remplacer – c’est-à-dire transplanter un cerveau humain dans un corps robotique à cet effet ? Cette solution nous libèrerait de l’essentiel de nos limitations physiques. Malheureusement, elle ne changerait rien à notre principal handicap, l’intelligence limitée du cerveau humain. Dans ce scénario, notre cerveau est transplanté hors du corps. Existe-t-il à l’inverse un moyen d’extirper notre esprit de notre cerveau ? ((Hans Moravec, Une vie après la vie (Odile jacob, 1992), pages 133-134. L’édition originale du livre a été publiée aux États-Unis chez Havard University Press sous le titre Mind Children : the Future of Robot and Human Intelligence en 1988))
Et le chercheur, très sérieusement, de répondre par la positive. Le Robocop en « downloading » du scientifique Moravec peut-il seulement être qualifié de cyborg ?



Omnipresence, 1993
Paradoxalement, en 1993, l’artiste ORLAN n’est-elle pas plus cyborg que lui quand elle engage son corps dans Omniprésence ? Lorsqu’elle joue littéralement sa peau pour une opération de chirurgie esthétique visant à transformer radicalement son visage par deux implants au niveau de ses tempes, elle clame et réclame son droit à une singularité absolue. Là où Moravec reste abstrait, idéologique, et ne met en jeu que sa réputation, elle transforme sa théorie en acte, au cœur du réel le plus tangible. Qu’on l’apprécie ou non, cette construction d’une réalité on ne peut plus charnelle creuse toute la différence. Aux dangereux délires du roboticien, de l’ordre de la pure spéculation sous sa carapace objectiviste, ORLAN répond par la subjectivité d’une monstrueuse beauté qu’elle met en forme devant le parterre de l’art et de la bonne société.
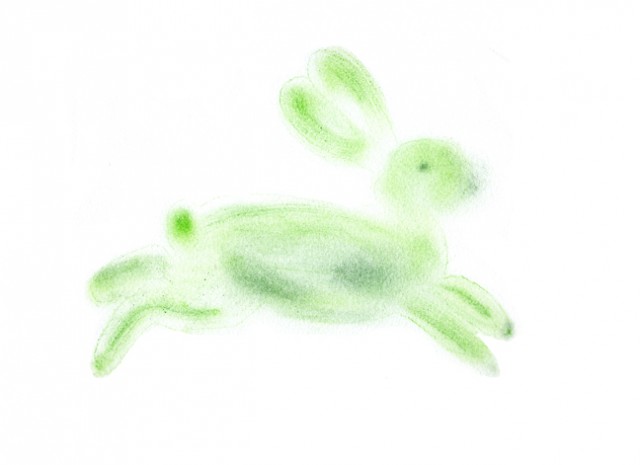
Eduardo Kac, Éloge de la singularité, 2002
« Ceci est mon corps…Ceci est mon logiciel… », raconte-t-elle au travers d’une autre de ses œuvres. Héritière de Donna Haraway, ORLAN est la Madone des Self-hybridations, selon le nom des mutations informatiques de son visage en multiples icônes précolombiennes, africaines et amérindiennes. Sur le registre du bio-art, que la Dame infiniment sculptée a effleuré récemment de son Manteau d’Arlequin, œuvre constituée d’un mariage de ses propres cellules avec celles d’animaux, il faudrait également citer Alba, lapine fluo car transgénique d’Eduardo Kac, qu’il a « commandée » et qu’il aurait lâchée au cœur du monde pour que chacun accepte sa réalité d’animal cyborg, si le labo ayant mené l’opération de transplantation d’un gène de méduse n’avait pas refusé l’indispensable mise en liberté de ce mutant.
Kac anticipe notre devenir cyborg selon sa facette la plus vitale : il érige en œuvres des organismes vivants qu’il transforme et manipule pour montrer – au sens propre – notre humanité future, composée d’êtres hybrides génétiquement ou électroniquement modifiés, mêlant les spécificités de l’homme, du végétal, de l’animal et de la machine3.
Au risque de l’incompréhension voire du dérapage, ORLAN et Éduardo Kac choisissent leurs corps mutants contre les Super héros et les machines humanoïdes de « l’informatique de la domination ». Ils détournent à leurs propres fins les armes du pouvoir, et ainsi se mettent en danger. Ce qu’ils racontent, eux comme Keiichi Matsuda, c’est que l’hybridation, en elle-même, n’a pas la moindre valeur. Elle n’est qu’un procédé d’époque, qui se joue des ADN et des mariages des dieux et déesses du numérique. Il convient de s’en emparer, au-dedans comme surtout au-dehors des forces dominantes. L’enjeu est de ne pas laisser ce potentiel de l’hybridation tous azimuts entre les mains des instances de l’abrutissement généralisé. C’est ce que Keiichi Matsuda accomplit avec ses cités pour cyborgs de l’ère Internet, et ce qu’ont parfois réussi en pionniers ORLAN et Éduardo Kac.
Inscrivant leur devenir cyborg au présent, mettant en actes leur fiction de l’à-venir au-delà des mots, ils tissent une histoire vécue que peuvent s’approprier les gosses de l’ère du tout numérique et de la biogénétique. Pour qu’à leur tour, ils hybrident leur monde et pourquoi pas leur être, en toute singularité.
Retrouvez la première partie sur OWNI.
Illustrations: CC FLickR Derrick T., © Orlan, © Eduardo Kac
Article initialement publié dans le numéro 44 de la revue Multitudes, dans le cadre d’un dossier intitulé Hybrid’Actions
Également disponible sur le Cairn
 Image de Une par Marion Kotlarski
Image de Une par Marion Kotlarski
Retrouvez les autres articles de notre dossier Cyborg:
- la première partie de “Nous sommes tous des Cyborgs”
- Quelle sorte de cyborg vous-voulez être, par Xavier Delaporte
- l’entretien avec Ariel Kyrou autour de son ouvrage Google God.
- Donna Haraway, « Manifeste cyborg : science, technologie et féminisme socialiste à la fin du XXe siècle », dans Connexions, sous-titre « Art, réseau, média », textes réunis et présentés par Annick Bureaud et Nathalie Magnan (École nationale supérieure des Beaux-Arts, 2002), page 572 [↩]
- Donna Haraway, op. cit., page 555 [↩]
- Voir aussi l’interview réalisée par Cyril de Graeve et Ariel Kyrou en 2007 pour Chronic’art [↩]

Laisser un commentaire